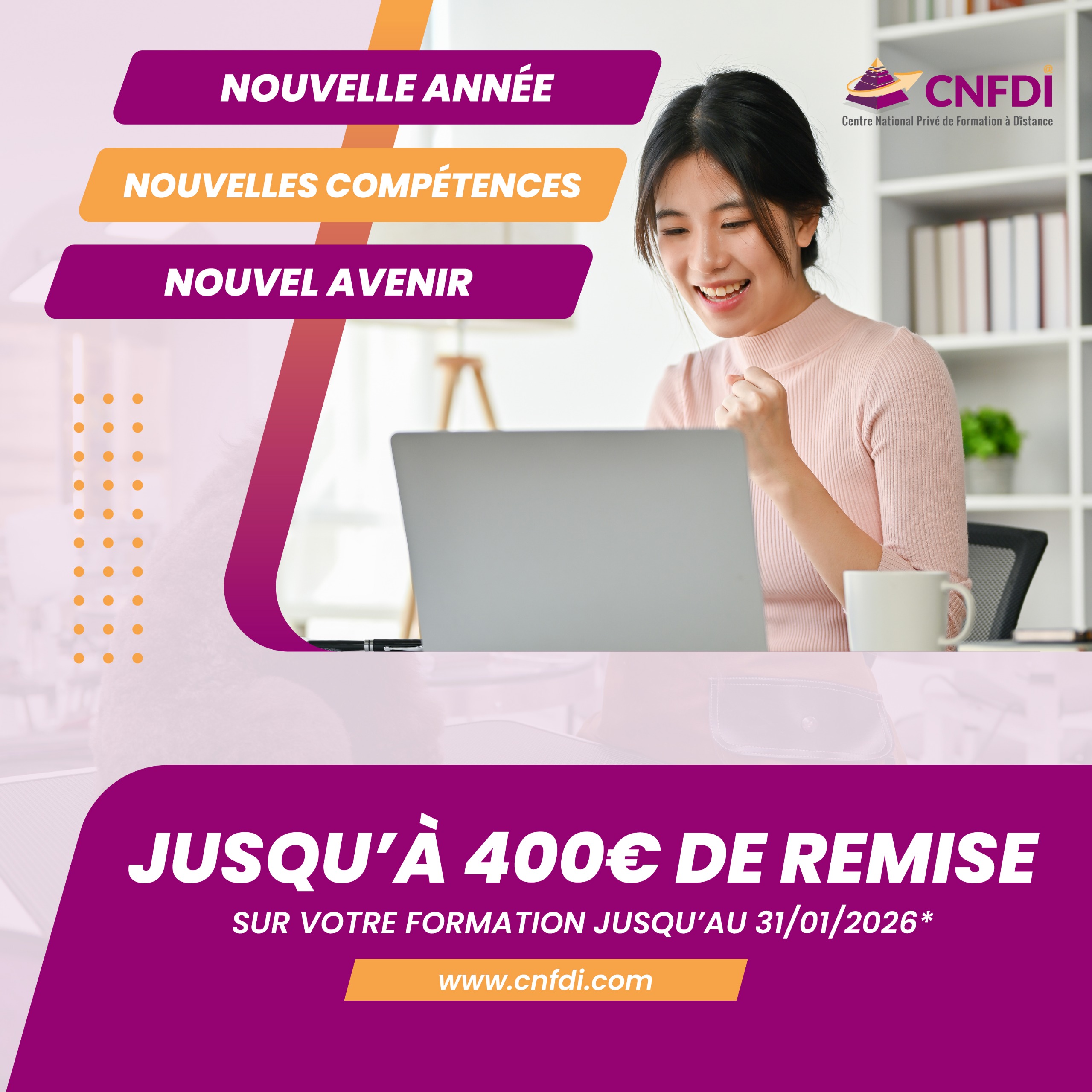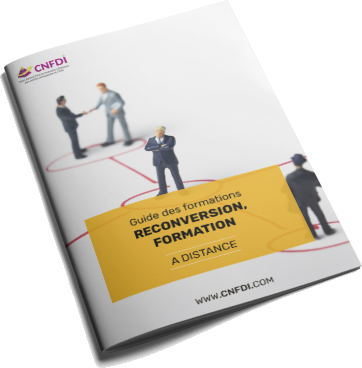- Conseils et accompagnement au 01 60 46 55 50
- Métiers
- Inscription
- Espace élève
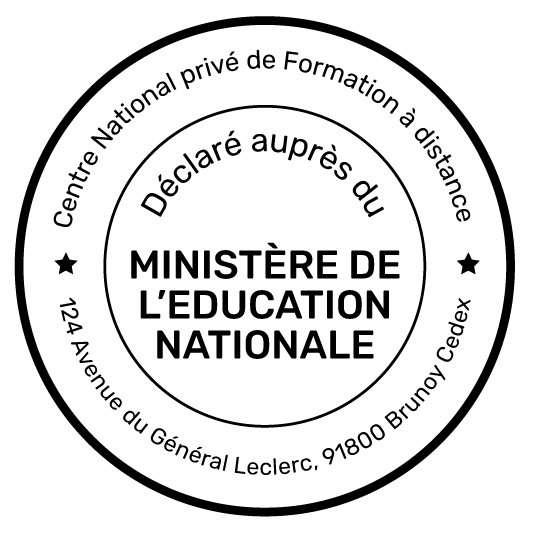

La norme RE2020 expliquée pour Les professionnels de l’immobilier

La norme RE2020, entrée progressivement en vigueur depuis le 1er janvier 2022, représente une révolution dans le secteur de la construction neuve en France. Cette réglementation environnementale est la première en France, et parmi les premières au monde, à intégrer la performance environnementale via l'analyse du cycle de vie complet des bâtiments.
Pour les professionnels du bâtiment, comprendre l'application de la réglementation RE2020 est désormais essentiel. Elle s'applique aux permis de construire déposés depuis janvier 2022 pour le résidentiel et juillet 2022 pour les bâtiments d'enseignement et bureaux. Cette nouvelle norme poursuit trois objectifs majeurs: la sobriété énergétique, la réduction de l'impact carbone, ainsi que la garantie du confort en période de forte chaleur. À noter également que la norme RE2020 pour les maisons individuelles impose des exigences spécifiques dès 2022, notamment concernant l'utilisation d'énergies renouvelables.
Contrairement à la précédente réglementation, la RE2020 ne se concentre plus uniquement sur l'énergie, mais accorde une place prépondérante aux matériaux utilisés. Elle met en application un principe fondamental : l'énergie la moins chère et la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas. De plus, cette réglementation prévoit plusieurs phases de renforcement des critères carbone et énergie en 2025, 2028 puis 2031.
Ce guide pratique transforme les exigences techniques de la RE2020 en décisions concrètes pour faciliter votre travail quotidien. Vous y trouverez des informations essentielles sur la méthode ACV simplifiée, le choix des isolants, la gestion des ponts thermiques et les documents justificatifs à fournir.
Passez de la théorie à la pratique RE2020
Maîtrisez les obligations techniques, les indicateurs et les pièces justificatives pour sécuriser vos opérations.
? Formation Gestion immobilière – CNFDI
Objectifs et calendrier d'application de la RE2020
La réglementation environnementale 2020 représente un changement de paradigme dans la construction neuve française. Elle succède à la RT2012 avec une portée environnementale plus ambitieuse, répondant aux exigences des lois de Transition énergétique pour la croissance verte (2015) et ELAN (2018). Cette norme vise à améliorer la performance énergétique, réduire l'impact climatique et adapter les bâtiments aux conditions climatiques futures.
Date application RE2020 selon le type de bâtiment
Le déploiement de la RE2020 suit un calendrier précis selon les types de construction :
- 1er janvier 2022 : Bâtiments d'habitation (maisons individuelles et logements collectifs) et résidences de tourisme avec local de sommeil, cuisine et sanitaires [1]
- 1er juillet 2022 : Bureaux et bâtiments d'enseignement primaire ou secondaire [2] [1]
- 1er janvier 2023 : Extensions de bâtiments (habitation, bureaux, locaux d'enseignement) et constructions provisoires [1] [3]
- 1er juillet 2023 : Habitations légères de loisirs de moins de 35m² implantées dans les lieux de loisir [1] [2]
Par ailleurs, certaines constructions ont bénéficié d'un délai d'application :
- Les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m² et les extensions inférieures à 150 m² sont restées soumises à la RT2012 jusqu'au 31 décembre 2022 [1]
- Les constructions ayant donné lieu à la signature d'un contrat de louage d'ouvrage avant le 1er octobre 2021 ont continué à appliquer la RT2012 [1]
L'objectif de ce déploiement progressif était de permettre aux professionnels de s'adapter aux nouvelles exigences, notamment à un "bouleversement de certaines pratiques" [4].
Différences entre RT2012 et RE2020
La transition de la RT2012 vers la RE2020 s'accompagne de changements fondamentaux que tout dessinateur en bâtiment doit maîtriser :
Changement d'approche :
- La RT2012 était une réglementation thermique concentrée sur l'efficacité énergétique
- La RE2020 est une réglementation environnementale intégrant l'analyse du cycle de vie complet du bâtiment [5]
Évolutions techniques majeures :
- Nouvelle surface de référence : passage de la ShonRT à la SHAB (surface habitable) pour le résidentiel et la SU pour le tertiaire, 15 à 30% plus petite que la ShonRT [6]
- Élargissement du périmètre des consommations prises en compte :
- Ajout des consommations liées aux ascenseurs et escalators
- Intégration de l'électricité dans les parkings (éclairage et ventilation)
- Prise en compte de l'éclairage des circulations en logement collectif [6]
- Renforcement des exigences énergétiques :
- Efficacité énergétique de l'enveloppe environ 30% plus performante que sous la RT2012 [2]
- Évolution du coefficient de conversion en énergie primaire de l'électricité de 2,58 à 2,3 [1]
- Introduction de l'empreinte carbone :
- Calcul sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment sur une durée de 50 ans [6]
- Évaluation de l'impact des matériaux et des énergies
- Amélioration du confort d'été :
Ces modifications impliquent désormais des allers-retours entre le calcul thermique et le calcul de l'empreinte environnementale, car les deux aspects sont intimement liés dans la méthode de calcul RE2020 [6].
La trajectoire d'application prévoit également un renforcement progressif des exigences avec trois jalons prévus en 2025, 2028 et 2031 [7]. Cette progressivité permet aux acteurs de la construction de s'adapter tout en gardant un cap clair vers des bâtiments de plus en plus performants et décarbonés.
Les 6 indicateurs réglementaires à connaître
Pour se conformer à la norme RE2020, six indicateurs réglementaires doivent être respectés. Chacun possède des seuils spécifiques qui s'appliquent aux différents types de construction. Voici ce que vous devez maîtriser pour concevoir un bâtiment conforme.
Bbio : Besoin bioclimatique
Le Bbio évalue l'efficacité énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques installés. Cet indicateur s'exprime en points (sans unité) et concerne trois postes de consommation : les besoins en chauffage, en refroidissement et en éclairage [2].
La formule de calcul a évolué et s'établit désormais comme suit : Bbio = 2 × (Besoin chauffage + Besoin refroidissement) + 5 × Besoin éclairage [2]
À noter que le Bbio RE2020 est environ 30% plus exigeant que celui de la RT2012 [2]. Pour une maison individuelle, le seuil Bbio_maxmoyen est fixé à 63 points, tandis qu'il atteint 65 points pour les logements collectifs [4].
L'objectif principal est d'inciter à une conception bioclimatique efficace : orientation optimale, compacité du bâti, gestion des apports solaires et lumineux en toutes saisons [2]. En effet, la RE2020 prend désormais systématiquement en compte les besoins de refroidissement, ce qui n'était pas le cas avec la RT2012 [1].
Cep et Cep,nr : Consommation d'énergie primaire
Ces deux indicateurs s'expriment en kWhep/(m².an) et évaluent la consommation énergétique du bâtiment.
Le Cep représente la consommation totale d'énergie primaire, qu'elle soit renouvelable ou non [4]. Il prend en compte les cinq usages de la RT2012 (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires), ainsi que de nouveaux usages : éclairage des parties communes, ascenseurs, et parkings [1].
Le Cep,nr est une nouveauté de la RE2020. Il comptabilise uniquement les consommations d'énergie primaire non renouvelable [4]. Ainsi, la consommation d'une chaufferie bois ou la part renouvelable d'un réseau de chaleur ne sont pas comptabilisées dans cet indicateur [1].
Pour les maisons individuelles, le Cep,nr_maxmoyen est fixé à 55 kWhep/(m².an), tandis que le Cep_maxmoyen est de 75 kWhep/(m².an) [3].
Icénergie : Impact carbone de l'énergie
Cet indicateur évalue les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie sur toute la durée de vie du bâtiment, établie à 50 ans [4]. Il s'exprime en kg équivalent CO?/m² [4].
L'Icénergie a un impact direct sur le choix des systèmes énergétiques. Par exemple, dès 2022, les solutions 100% gaz ne peuvent généralement plus être conformes pour les maisons individuelles et les bureaux [4]. Les seuils seront progressivement renforcés entre 2022 et 2028 pour favoriser l'utilisation d'énergies décarbonées [4].
Pour les maisons individuelles, le seuil Icénergie_maxmoyen est fixé à 160 kg éq. CO?/m² dès 2022 [4].
Icconstruction : Impact carbone des matériaux
L'Icconstruction représente l'impact sur le changement climatique des produits de construction, des équipements et de leur mise en œuvre [8]. Il s'exprime également en kg équivalent CO?/m² [4].
Pour une maison individuelle, le seuil Icconstruction_maxmoyen est fixé à 640 kg éq. CO?/m² entre 2022 et 2024, puis sera progressivement abaissé jusqu'à 415 kg éq. CO?/m² à partir de 2031 [4].
Ce dispositif vise à encourager l'utilisation de matériaux à faible impact carbone comme le bois, les matériaux biosourcés ou recyclés [6].
DH : Degrés-heures d'inconfort
Cet indicateur remplace la Température Intérieure Conventionnelle (Tic) de la RT2012 [5]. Il s'exprime en °C.h et mesure la durée et l'intensité des périodes d'inconfort estival [1].
Le DH comptabilise la somme des écarts entre la température opérative du groupe et la température de confort adaptatif (entre 26°C et 28°C le jour, 26°C la nuit) [1]. Le calcul est réalisé avec un scénario caniculaire de référence de type année 2003 [1].
Deux seuils ont été définis :
- Un seuil bas de 350 DH, en dessous duquel le bâtiment est jugé confortable [5]
- Un seuil haut de 1250 DH, au-dessus duquel le bâtiment est non conforme [5]
Icbâtiment : Indicateur global
L'Icbâtiment est un indicateur informatif qui représente l'ensemble des impacts sur le changement climatique de l'opération [9]. Il correspond à la somme de l'Icconstruction et de l'Icénergie, ainsi que de l'impact des consommations et rejets d'eau pendant l'exploitation [10].
Cet indicateur n'est pas soumis à un seuil réglementaire pour l'instant, mais il permet d'avoir une vision globale de l'empreinte carbone du bâtiment [8].
Pour le dessinateur en bâtiment, comprendre ces six indicateurs est essentiel car ils influencent directement les choix de conception, depuis l'orientation du bâtiment jusqu'à la sélection des matériaux et des systèmes énergétiques.
Méthode ACV simplifiée pour les dessinateurs
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) constitue la pierre angulaire de la norme RE2020. Pour les dessinateurs en bâtiment, maîtriser cette méthode permet d'optimiser les choix de conception dès les premières esquisses. Voici les points essentiels à comprendre pour intégrer efficacement l'ACV dans vos projets.
Cycle de vie sur 50 ans : PER
L'ACV d'un bâtiment s'évalue sur une Période d'Étude de Référence (PER) fixée à 50 ans par la réglementation [11]. Cette durée standardisée permet d'analyser tous les impacts environnementaux du bâtiment depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie.
Le calcul ACV prend en compte cinq étapes principales :
- Production (A1-A3) : extraction des matières, transport vers l'usine, fabrication
- Construction (A4-A5) : transport vers le chantier, mise en œuvre
- Utilisation (B1-B7) : usage, maintenance, remplacement des matériaux
- Fin de vie (C1-C4) : déconstruction, transport, traitement des déchets
- Bénéfices et charges (D) : potentiel de recyclage et valorisation [12]
En pratique, lors de la phase d'avant-projet sommaire (APS), réalisez une première étude d'ACV simplifiée pour identifier les lots les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Ces lots pourront ensuite faire l'objet d'optimisations ciblées [7].
Composants vs chantier vs énergie
L'ACV d'un bâtiment se décompose en plusieurs contributions distinctes :
- Composants : tous les produits de construction et équipements, y compris les réseaux et parkings. Ce poste englobe l'ensemble du cycle de vie des matériaux, de leur production à leur fin de vie [13].
- Énergie : toutes les consommations d'énergie pour le chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires pendant les 50 ans d'exploitation [13][11].
- Chantier : consommations d'énergie et d'eau durant la phase de construction, ainsi que les déchets de terrassement [13][7].
Pour les dessinateurs, il est essentiel de savoir que la phase de construction est responsable d'une part significative des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment sur toute sa durée de vie [14]. Par conséquent, les choix de conception ont un impact déterminant sur l'empreinte carbone globale du projet.
Utilisation des FDES et PEP dans INIES
La base INIES (www.inies.fr) constitue la référence nationale pour les données environnementales des produits et équipements du bâtiment [13]. En 2025, elle recense plus de 6 200 déclarations environnementales spécifiques, dont 4 782 Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour les produits de construction et 1 464 Profils Environnementaux Produits (PEP) pour les équipements [15].
Pour réaliser vos calculs ACV :
- Identifiez les produits et équipements de votre projet
- Recherchez les FDES ou PEP correspondants dans la base INIES
- Utilisez ces données dans un logiciel de calcul RE2020 validé
Si une FDES spécifique n'existe pas, utilisez une Donnée Environnementale par Défaut (DED), mais sachez que ces données sont généralement plus pénalisantes [10].
Pour simplifier ce processus, des configurateurs validés pour la RE2020 sont disponibles, comme BETie, SAVE, DE-Bois, PHARE ou Config'Alu. Ces outils permettent de paramétrer les déclarations environnementales selon les dimensions ou la composition spécifiques à votre projet [10].
Réemploi et matériaux biosourcés
La RE2020 valorise particulièrement deux approches pour réduire l'impact carbone :
- Le réemploi : les composants issus du réemploi ou de la réutilisation sont considérés comme n'ayant aucun impact environnemental. Les valeurs des impacts pour tous les modules du cycle de vie sont donc nulles [10]. Néanmoins, vous devez pouvoir attester de la traçabilité des produits réemployés et comptabiliser les impacts des produits complémentaires nécessaires à leur mise en œuvre.
- Les matériaux biosourcés : la RE2020 encourage leur utilisation grâce à l'ACV dynamique qui tient compte du stockage carbone sur la durée de vie du bâtiment [16]. Ces matériaux présentent un double avantage : une empreinte carbone réduite lors de leur production et une capacité à stocker le carbone durant leur vie [11].
Pour optimiser l'impact carbone, privilégiez les produits durables, car leur durée de vie (indiquée dans la FDES ou le PEP) influence directement la performance environnementale du projet [17]. En effet, plus un produit dure longtemps, moins son impact est important sur la PER de 50 ans.
Choisir les bons isolants pour respecter le Bbio
Le choix des matériaux isolants représente un facteur déterminant pour atteindre les exigences du Bbio dans la norme RE2020. Pour les dessinateurs en bâtiment, sélectionner les isolants adaptés dès la phase de conception constitue un levier majeur d'optimisation thermique et environnementale.
Isolants biosourcés vs conventionnels
Les isolants biosourcés offrent plusieurs avantages significatifs par rapport aux solutions conventionnelles dans le cadre de la RE2020. D'après les analyses comparatives, l'impact environnemental des isolants biosourcés est environ 4 fois moins important que celui des isolants conventionnels comme la laine de verre ou la laine de roche [18]. Cette différence provient principalement de la phase de production, durant laquelle les isolants conventionnels émettent la majorité de leurs gaz à effet de serre.
Par ailleurs, les isolants biosourcés présentent un atout considérable : ils absorbent le CO? durant leur croissance, créant ainsi un effet de "puits de carbone" [2]. Certains peuvent même afficher un bilan carbone négatif grâce à ce phénomène de séquestration.
Les principales caractéristiques qui distinguent ces deux familles d'isolants sont :
- Densité et capacité thermique : Les isolants biosourcés possèdent généralement une densité et une capacité thermique massique plus élevées [18]
- Déphasage thermique : Les isolants biosourcés offrent des déphasages de 6 à 10 heures, soit 2 à 3 fois supérieurs aux isolants minéraux [18]
- Atténuation d'amplitude : Jusqu'à 80% pour les biosourcés contre environ 20% pour les isolants conventionnels [18]
En pratique, pour un dessinateur souhaitant optimiser le Bbio d'un projet, les isolants comme la ouate de cellulose, les fibres de bois, le chanvre ou la paille constituent des options particulièrement pertinentes dans le cadre de la RE2020 qui valorise leur faible empreinte carbone [2].
Épaisseurs minimales selon zones climatiques
Pour respecter les exigences de la RE2020, l'épaisseur d'isolation doit être adaptée en fonction de la résistance thermique (R) souhaitée et de la conductivité thermique (λ) du matériau choisi. La formule à appliquer est : Épaisseur (cm) = λ × R × 100 [19].
Les coefficients de résistance thermique recommandés varient selon la partie du bâtiment à isoler :
- Toiture terrasse : R = 8 m²·K/W [19]
- Rampants : R = 8,5 m²·K/W [19]
- Combles perdus : R = 9 m²·K/W [19]
- Murs extérieurs : R = 4 m²·K/W [19]
- Planchers bas : R = 3,7 m²·K/W [19]
Ces valeurs représentent un durcissement significatif par rapport à la RT2012. À titre d'exemple, pour les murs extérieurs, la RE2020 implique une épaisseur d'isolation beaucoup plus importante : environ 300 mm contre 0 à 100 mm auparavant selon le type d'isolant et la zone climatique [20].
Dans le cas des panneaux de fibre de bois semi-rigides, une épaisseur de 28 cm suffit généralement pour atteindre un coefficient R de 7 m²·K/W [20], ce qui correspond à une isolation très performante.
Impact sur le confort d'été (DH)
Le choix des isolants influence directement l'indicateur DH (degrés-heures) qui mesure l'inconfort estival. La RE2020 fixe deux seuils de référence : un seuil bas de 350 DH en dessous duquel le bâtiment est jugé confortable, et un seuil haut de 1250 DH au-delà duquel il est non conforme [21].
Les isolants biosourcés contribuent efficacement au confort d'été grâce à leurs propriétés spécifiques :
- Leur déphasage thermique élevé retarde la transmission de la chaleur extérieure vers l'intérieur du bâtiment. Pour la ouate de cellulose (300 mm), le déphasage atteint 10,7 heures contre seulement 4,2 heures pour la laine de verre en rouleau de même épaisseur [1].
- Leur capacité d'atténuation réduit l'amplitude des variations de température. Ainsi, avec une atténuation de 80%, une température extérieure de 35°C ne générera qu'une élévation de température intérieure de 7°C [18].
Pour optimiser l'indicateur DH, le dessinateur doit néanmoins combiner une isolation performante avec d'autres stratégies : protections solaires efficaces (volets roulants à l'est et à l'ouest, pergolas au sud), ventilation traversante pour évacuer la chaleur nocturne, et forte inertie intérieure avec des parois lourdes [2].
La RE2020 encourage donc une approche globale où l'isolation ne peut être dissociée des autres aspects de la conception bioclimatique pour atteindre simultanément la performance énergétique et le confort d'été.
Réduire les ponts thermiques dès la conception
Les ponts thermiques représentent des zones où la résistance thermique est rompue, entraînant des pertes énergétiques significatives qui peuvent atteindre 40% des déperditions totales d'un bâtiment [3]. Pour respecter la RE2020, leur traitement doit être anticipé dès la phase de conception.
Zones critiques : plancher, toiture, menuiseries
Les ponts thermiques se manifestent principalement aux points de jonction entre différentes parois. Les zones les plus critiques sont :
- Les liaisons murs/planchers (bas et intermédiaires), particulièrement à l'about de dalle [22]
- Les connexions murs/toiture où la continuité de l'isolant est souvent interrompue [22]
- Les jonctions autour des menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres) [22]
- Les balcons qui génèrent des ponts thermiques majeurs lorsqu'ils sont en continuité avec la structure [4]
- La semelle de fondation qui constitue le pont thermique le plus important [23]
Ces zones critiques se classent en deux catégories : les ponts thermiques linéaires (entre deux parois) et ponctuels (entre trois parois) [22]. Dans les deux cas, ils créent des discontinuités thermiques qui compromettent l'efficacité énergétique globale du bâtiment.
Solutions : rupteurs, continuité de l'isolant
Pour traiter efficacement les ponts thermiques, plusieurs solutions techniques existent :
- L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) reste la méthode la plus efficace car elle assure l'homogénéité thermique des parois et évite la plupart des ponts thermiques de plancher [23]. Cette technique enveloppe l'ensemble du bâtiment du sol jusqu'à la toiture [22].
- Les rupteurs thermiques sont des dispositifs structurels placés aux jonctions critiques. Ils peuvent réduire le coefficient de transmission thermique linéique (ψ) d'environ 0,15 à 0,40 W/(m.K) [24]. Pour les balcons, ils permettent d'atteindre un ratio (ψ) entre 0,25 et 0,50 W/m.K [4].
- Les retours d'isolant allongent le parcours de la chaleur sur 30 à 60 cm aux intersections, réduisant considérablement les déperditions thermiques [25].
- Les bétons légers structurels pour les voiles de façades peuvent réduire les déperditions par pont thermique d'au moins 35% par rapport aux bétons standards [23].
- L'utilisation de matériaux isolants performants comme le polyuréthane (PUR), le polyisocyanurate (PIR) ou le polystyrène expansé (EPS) aux zones critiques [26].
Lien entre ponts thermiques et Bbio
Le traitement des ponts thermiques influence directement l'indicateur Bbio de la RE2020 :
- Dans le cadre de la RE2020, le ratio de transmission thermique linéique moyen global (ratio ψ) ne doit pas excéder 0,28 W/(m²SHONrt.K) [4]
- Le coefficient moyen de transmission thermique linéique des liaisons entre planchers intermédiaires et murs extérieurs ne doit pas dépasser 0,6 W/(m.K) [4]
Au-delà de l'aspect énergétique, les ponts thermiques non traités entraînent :
- Des risques de condensation superficielle côté intérieur [3]
- Le développement potentiel de moisissures et de pathologies du bâti [22]
- Une diminution du confort thermique avec l'apparition de parois froides [22]
Par conséquent, pour optimiser le Bbio, le dessinateur doit prévoir des solutions de traitement des ponts thermiques dès les premières esquisses, en privilégiant une approche globale d'isolation continue et en intégrant les rupteurs thermiques aux points stratégiques.
Attestation RE2020 et pièces justificatives
Pour respecter la norme RE2020, deux attestations officielles sont exigées à des moments clés du projet. Ces documents garantissent la conformité du bâtiment aux exigences énergétiques et environnementales tout au long du processus de construction.
Attestation au dépôt du permis de construire
L'attestation initiale, obligatoire pour obtenir le permis de construire, doit être jointe au document Cerfa n°13406-03 en tant que pièce PCMI 14-2 [8]. Établie par le maître d'ouvrage, elle atteste :
- Du respect des seuils Bbio et DH (degrés-heures) [6]
- De l'engagement à pouvoir justifier, avant le début des travaux, du respect des indicateurs Icénergie et Icconstruction [6]
- Du respect de l'exigence d'accès à l'éclairage naturel (pour les bâtiments d'habitation) [6]
- De l'engagement à vérifier les systèmes de ventilation [6]
Cette attestation est générée numériquement à partir des résultats du calcul réglementaire effectué par un bureau d'études thermiques [27]. À cette étape, seules les parties RSET (thermique) et Datas_comp (informations générales) sont requises [5].
Attestation à l'achèvement des travaux
La seconde attestation doit être fournie avec la déclaration d'achèvement des travaux (DAACT) [28]. Contrairement à la première, elle doit être établie par un contrôleur indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre [28]. Ce professionnel peut être :
- Un architecte
- Un diagnostiqueur DPE (uniquement pour les maisons individuelles)
- Un contrôleur technique
- Un organisme certificateur (Cerqual, Prestaterre ou Promotelec Services) [6]
Ce document certifie :
- Le respect de tous les indicateurs réglementaires (Bbio, Cep, Cep,nr, Icénergie, Icconstruction, DH) [6]
- Les caractéristiques thermiques du bâtiment (isolation, protections solaires) [29]
- Les résultats du test de perméabilité à l'air [28]
- La vérification des systèmes de ventilation [6]
Le non-respect des exigences peut entraîner des sanctions pouvant atteindre 45 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive [28]. Toutefois, les autorités permettent généralement une mise en conformité du projet [28].
Fichier RSEE : contenu et format XML
Le Récapitulatif Standardisé d'Étude Énergétique et Environnementale (RSEE) est le document technique central de la RE2020 [5]. Ce fichier au format XML comprend trois parties principales :
- RSET : partie thermique (consommations énergétiques)
- RSEnv : partie environnementale (analyse du cycle de vie)
- Datas_comp : informations générales du projet [5]
Pour l'attestation d'achèvement des travaux, les trois parties doivent être complètes [5]. Le contrôleur utilise ce fichier pour vérifier la cohérence entre l'étude initiale et la réalisation effective [28].
Le RSEE peut être visualisé via plusieurs méthodes : navigateurs spécifiques, logiciels comme ClimaWin, ou plateformes en ligne comme www.bbs-logiciels.com/suppport/rsee [9]. Pour les projets complexes, le document PDF généré à partir du RSEE peut dépasser 100 pages [30].
Outils et logiciels validés pour le calcul RE2020
La mise en œuvre de la norme RE2020 exige l'utilisation de logiciels spécifiques, validés par les ministères chargés de l'énergie et de la construction. Ces outils se divisent en trois catégories : thermique seul, environnement seul, ou thermique et environnement combinés.
Logiciels thermiques : Pleiades, ClimaWin, etc.
Pour les calculs énergétiques, plusieurs logiciels ont obtenu l'approbation ministérielle nécessaire. Pleiades RE2020 énergie propose une saisie graphique permettant de modéliser rapidement le bâtiment et de calculer automatiquement les caractéristiques géométriques essentielles (surfaces, inertie, coefficients b) [31]. Ce logiciel évalue les indicateurs de confort d'été (DH) et d'énergie (BBio, Cep,nr, Cep).
ClimaWin offre quant à lui la possibilité de traiter les volets énergétiques et environnementaux conjointement dans une même étude [32]. Ce logiciel permet égale


Thématiques
Derniers articles publiés




Pourquoi se former avec le CNFDI